
En coulisse
Pourquoi achetons-nous des choses dont nous n'avons pas besoin?
par Kevin Hofer

Même si j’aime me convaincre du contraire, il est très rare que mes achats soient uniquement motivés par leur utilité pratique. Thorstein Veblen a analysé dès 1899 les motivations des consommateurs dans sa «Théorie de la classe de loisir». Difficile de dire si le caractère satirique de l’œuvre est intentionnel ou non, quoi qu’il en soit, il vaut la peine d’être lu encore aujourd’hui.
Pourquoi achetons-nous en permanence des choses dont nous n’avons pas besoin? C’est la question que s’est posée notre collègue Kevin Hofer il y a quelque temps.
Plusieurs explications très différentes existent: psychologiques, sociales, économiques. Thorstein Veblen a développé une théorie complète sur la question dès 1899, une théorie qui lui a valu bien des inimitiés. Non pas parce qu’elle était manifestement erronée, mais parce qu’elle mettait à jour des constatations désagréables que personne ne voulait entendre. Le titre de la version originale «Theory of the leisure class» a été traduit en français par «Théorie de la classe de loisir».
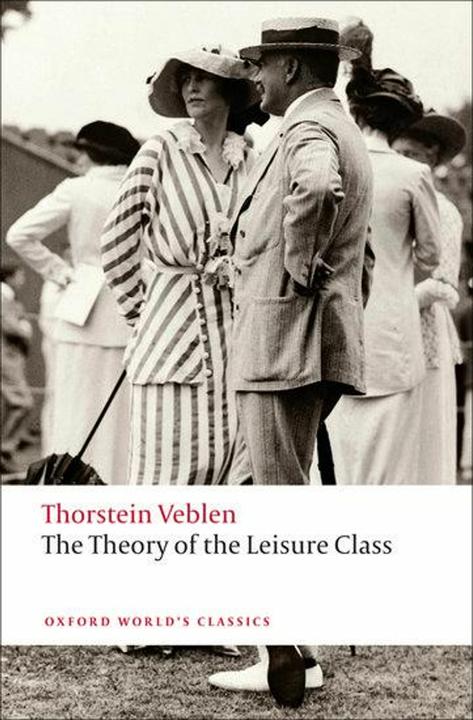
The Theory of the Leisure Class
Anglais, Martha Banta, Thorstein Veblen, 2009
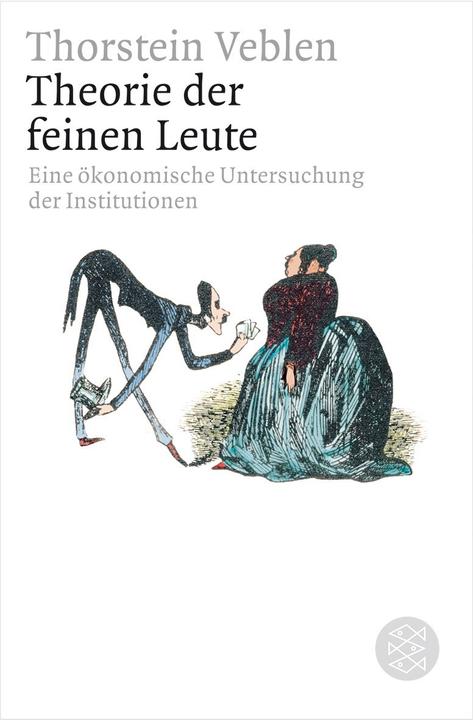
Veblen était économiste, mais aujourd’hui on associerait plutôt son travail à la sociologie, voire on lui dénierait toute qualité scientifique. En effet, il ne s’appuie sur aucune preuve: chiffres, statistiques ou études. Sa théorie est une pure construction de son esprit, à l’instar des idées de Freud, Marx (économiste lui aussi) ou Darwin. Certains passages se lisent comme une satire sociale.
L’idée centrale est simple : les êtres humains achètent des choses pour établir leur statut social. La possession de certains produits marque l’appartenance à une certaine classe sociale. Cette constatation ne surprendra personne, tout le monde connaît aujourd’hui le terme de «signe extérieur de richesse». Ou bien encore cette citation qui est bien plus ancienne que le film «Fight Club»:
We buy things we don’t need with money we don’t have to impress people we don’t like. (Nous achetons des choses dont nous n’avons pas besoin avec de l’argent que nous n’avons pas pour impressionner des gens que nous n’aimons pas.)
Cependant, Veblen développe à partir de ce postulat une théorie détaillée qui lui permet d’expliquer les aspects les plus variés du comportement humain. En plus de la consommation, il aborde la position de la femme dans la société, les diktats de la mode, les canons de beauté, la glorification de la guerre, de la chasse et de la violence, les rituels religieux ou bien encore pourquoi les citadins sont plus à la mode que les habitants des campagnes.
D’après Veblen, il existe dans toutes les sociétés humaines – hormis les peuples primitifs – une classe privilégiée avide d’afficher sa supériorité. Ce qui change avec le temps, ce sont les méthodes utilisées pour démontrer ce pouvoir.
Avant la révolution industrielle, le nombre de produits est très limité, comparé à aujourd’hui. Même les privilégiés ne possèdent donc que peu de choses. Leur privilège réside surtout dans le fait d’avoir des domestiques. Autrement dit, ils n’ont pas à travailler.
Ce privilège est défendu, mais pas par paresse. D’après Veblen, chaque être humain est naturellement doué d’un «instinct de travail», c’est-à-dire qu’il est volontiers enclin à faire quelque chose. Mais les conventions l’interdisent. Cette oisiveté ostentatoire sert avant tout à établir le pouvoir et le prestige d’un individu. C’est pourquoi «il ne suffit pas de posséder la richesse et la puissance. Elles doivent être apparentes, car ce n’est qu’ainsi qu’elles inspirent le respect.»
Veblen appelle cela «l’oisiveté ostentatoire».
On pourrait imaginer qu’une personne donne toutes les apparences de la fainéantise tout en travaillant d’arrache-pied en secret. La difficulté pour les membres de la classe supérieure consiste donc à prouver qu’ils ne font rien de productif, même quand ils sont seuls. La solution: afficher ses talents pour des activités non productives ou dont l’apprentissage est extrêmement long. Citons par exemple la maîtrise d’instruments de musique, des règles de politesse complexes ou l’art raffiné de la conversation. La personne qui maîtrise toutes ces choses absolument inutiles à la survie d’un être humain montre ainsi qu’elle dispose de beaucoup de temps libre.

Les privilégiés essaient naturellement de surenchérir les uns contre les autres. L’oisiveté ostentatoire finit par prendre des formes absurdes. Ceux qui peuvent se le permettre engagent alors plus de domestiques que ce dont ils ont besoin pour se décharger de leur travail. Cela aussi est un signe extérieur de richesse. Il existe ainsi parmi les domestiques des personnes qui n’exécutent aucun travail productif, ceux-ci dominent la hiérarchie des domestiques.
Ils réalisent certes des tâches pour que chacun voie que ce sont bien des domestiques. Un principe se dégage cependant: moins cette tâche est nécessaire, plus elle témoigne de la richesse et de la puissance de l’employeur. Par exemple, un domestique haut gradé accueille les invités, mais ne portera jamais leurs bagages – cette tâche est confiée à un employé de rang inférieur. Avec un cérémonial aussi complexe, le propriétaire montre qu’il peut se permettre toutes les dépenses de personnel. Plus c’est déraisonné, mieux c’est.
Avec le capitalisme et l’industrialisation, l’importance des biens augmente considérablement. D’une part, parce que les biens de valeur se multiplient et qu’ils permettent de mieux se démarquer. D’autre part, parce que ces biens vont de pair avec des machines qui travaillent à la place des êtres humains et remplacent les domestiques. La richesse est de plus en plus définie comme une accumulation de biens. À cela correspond la valeur-travail, une théorie économique du 19e siècle. Elle prévoit que la valeur d’une marchandise est constituée par le temps de travail nécessaire pour la produire.
Les marchandises sont donc d’une certaine manière le résultat du travail des domestiques. Logiquement, les biens doivent aussi représenter un gaspillage luxueux s’ils sont censés montrer que l’acheteur est riche et puissant. La conséquence est claire: les produits sont achetés non pas en dépit, mais précisément parce qu’ils sont inutiles. L’acheteur montre ainsi qu’il est assez riche pour se permettre d’acheter des choses inutiles. La consommation ostentatoire est née.
Bien entendu, rares sont les signes extérieurs de richesse complètement inutiles, mais ils sont étonnamment nombreux à comporter des composants irrationnels. Veblen observe par exemple la préférence des riches pour les produits fabriqués à la main, dont la qualité n’est pas meilleure que ceux fabriqués industriellement, mais qui sont simplement plus chers. Selon sa théorie, ces produits sont surtout achetés parce que tout le monde ne peut pas se les offrir.
Si la prodigalité marque l’appartenance à une classe privilégiée, il est important qu’elle réponde aux normes sociales. Il ne s’agit donc pas de jeter l’argent par les fenêtres, mais de le faire de la manière la plus en vogue. Veblen consacre donc un chapitre complet à l’esthétique et aux questions de goût.
Les objets faits à la main sont souvent beaux, mais ce n’est pas la vraie raison pour laquelle ils sont prisés. Ils sont recherchés parce qu’ils sont chers, à cause de «notre préférence pour les objets chers que nous affublons du masque de la beauté».
Veblen constate qu’en règle générale, beaucoup de choses sont considérées comme belles parce qu’elles sont chères et non le contraire. Les fleurs, qui sont certes belles, mais qui poussent partout et sont donc accessibles à tous sont considérées comme de mauvaises herbes. À l’inverse, des animaux domestiques laids, mais rares, sont considérés comme beaux: «De nombreuses personnes trouvent même belle une race de chiens qu’un amateur aura créée à force de croisements jusqu’à rendre l’animal méconnaissable. Chez ces races de chiens, [...] la valeur esthétique est plus ou moins proportionnelle au degré d’absurdité et d’inconstance de la mode responsable de l’élevage de telles monstruosités.» La raison: «La valeur commerciale de ces créatures hideuses repose sur un coût de production élevé.»

Les vêtements occupent une place de choix dans les questions de goût. La valeur utilitaire joue un rôle complètement secondaire. La mode se prête particulièrement bien à la consommation ostentatoire parce qu’elle signale immédiatement l’appartenance à une classe sociale. La mode des classes sociales supérieures est toujours conçue pour restreindre le travail physique. Les gens de classe font ainsi d’une pierre deux coups en répondant à la fois aux impératifs de la consommation et de l’oisiveté démonstratives.

La consommation de biens inutilement chers qui correspondent au bon goût ne concerne pas uniquement les objets dont on fait étalage, mais aussi des choses comme les sous-vêtements ou les articles ménagers. En effet, les gens suivent ce modèle inconsciemment et se plient à un mode de pensée et de comportement général qui affecte tous les domaines.
La consommation ostentatoire ne se limite pas aux classes aisées. Les personnes moins fortunées tiennent beaucoup à ne pas paraître trop démunies. «Aucune classe, même pas les plus pauvres, ne renonce totalement à la consommation ostentatoire», écrit Veblen. Même si cela se solde par des privations douloureuses pour les proches. Selon Veblen, chaque classe envie celle qui lui est directement supérieure, et non l’élite. En effet, elle se prête à la comparaison directe et la «comparaison envieuse» est le moteur de la consommation ostentatoire.
Cette dernière est moins présente à la campagne qu’à la ville, car les gens se connaissent bien au point de connaître la situation financière de leurs voisins. Dans ce cas, il est difficile et inutile de faire semblant d’être riche. À la ville, la situation est différente. Les apparences signalent immédiatement à quelle classe on appartient.
La consommation ostentatoire n’est pas du tout irrationnelle. Elle remplit un objectif économique. La situation économique d’un individu dépend largement du milieu qu’il fréquente. C’est pourquoi l’achat de certains symboles de réussite sociale est nécessaire. C’est encore le cas aujourd’hui: un spécialiste en placements financiers doit se présenter à ses meilleurs clients au volant d’une voiture exorbitante, mais c’est un investissement qui s’avère rentable.
Selon Veblen, les premières classes sociales qui sont apparues dans l’histoire de l’humanité trouvent leur origine dans la répartition du travail entre les hommes et les femmes. À l’origine, le travail des hommes inclut la chasse et la guerre, alors que les femmes sont chargées de récolter la nourriture. Comme seul le travail des hommes est considéré comme dangereux, il est le seul a être qualifié d’héroïque. Dans le même temps, le travail des hommes requiert brutalité et prédation. Ces caractéristiques prédestinent l’homme à opprimer la femme.
Par conséquent, «il y a lieu de croire qu’à l’origine, la propriété s’exerçait sur les personnes, et notamment les femmes. Les raisons probables sont les suivantes: 1. le penchant pour l’autoritarisme et l’exercice de la coercition, 2. la valeur des femmes comme témoins vivants de la bravoure des hommes et 3. l’intérêt de leur travail.»
En une phrase, Veblen résume les motivations du machisme classique. Je trouve ce raisonnement remarquable étant donné que l’auteur vivait à une époque extrêmement patriarcale. Cela montre l’indépendance de sa pensée.
Veblen a aussi remarqué que l’idéal de beauté féminin s’adapte à la fonction que lui attribue le monde masculin. Tant que les hommes voient la femme en premier lieu comme une force de travail, celle-ci doit être «imposante et plantureuse» – et il n’est pas question de cacher ces qualités. En revanche, dans une société où l’oisiveté démonstrative concerne aussi la femme, celle-ci doit être aussi gracile, mince, voire fluette, que possible. Cette société apprécie le corset qui non seulement empêche tout travail productif, mais met aussi en valeur un corps affaibli.

Le livre de cet excentrique personnage est loin d’être au-dessus de tout soupçon. Il se fonde avant tout sur des allégations. L’auteur sélectionne les exemples et les aspects qui soutiennent sa théorie en ignorant ou en relativisant le reste. Néanmoins, son idée est convaincante dans les grandes lignes et chacun trouvera des exemples actuels pour l’étayer.
Veblen s’en prend à tous les milieux influents en même temps: les riches, les nobles qui ne travaillent pas, la classe politique, l’Église, mais aussi les érudits, dont il fait lui même partie. En effet, il ne se prive pas de tourner en dérision le milieu universitaire. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait fini sa vie complètement isolé et démuni.
Mon intéret pour l'informatique et l'écriture m'a mené relativement tôt (2000) au journalisme technique. Comment utiliser la technologie sans se faire soi-même utiliser m'intéresse. Dans mon temps libre, j'aime faire de la musique où je compense mon talent moyen avec une passion immense.